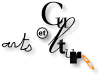Ancien
élève de l'école Louis Lumère (Paris), Bruno
Quinquet est ingénieur du son dans le milieu discographique. depuis
2000, il réalise en oute la sonorisation de vidéos. Ses
recherches personnelles autour des sons de la vie quotidienne se ratachent
directement à la " musique concrète " : collecte
puis manipulations d'un matériel sonore préexistant, aussi
bien le bruit que le son dit musical. L'installation présentée
au Musée Antoine-Lécuyer est un exemple de son travail.
C'est
en 1948, dans le club d'essai de la R.T.F. (Radio Télévision
Française), que le groupe de musique concrète fut créé
par Pierre Schaeffer (rejoint en 1949 par Pierre Henry qui à partir
de 1958 se consacrera surtout au son électronique). Bruno Quinquet
traite les sons sur ordinateur et non avec des magnétophones comme
Pierre Schaeffer dans les années 1950. Son objectif reste cependant
le même que celui de son aîné : non plus seulement
capter et retenir les sons mais les modifier, les transformer pour concevoir
un " objet sonore ", selon les mots de pierre Schaeffer : "
L'objet sonore, c'est ce que j'entends ; c'est une existence que je distingue...
Comment passe-t-on du sonore au musical ? Sonore, c'est ce que je perçois
; musical c'est déja un jugement de valeur. L'objet est d'abord
sonore avant d'être musical ".
Consacré
aux arts visuels, leMusée Antoine-Lécuyer est un lieu hautement
sonore. Quel visiteur n'a pas remarqué le bruit produit par l'entrechoquement
des lattes de son parquet sous les pas. Chacun l'explique comme il le
peut, avec plus ou moins d'humour : " parquet flottant ", "
système de sécurité "...La raison est simple.
Inauguré en 1932, le musée avait été concçu
sans protection solaire. Pendant plus de soixante ans, les salles reçurent
donc, par ses verrières zénithales et ses larges baies en
plein cintre, l'action combinée de la chaleur et des ultraviolets
du soleil. C'est ainsi que le bois se rétracta. Faute de n'être
plus parfaitement ajustées, les lattes se heurtent entre eles sitôt
qu'elles sont foulées, produisant ce bruit si particulier.
Initialement,
Bruno Quinquet avait l'idée de créer une composition sonore
à partir du seul parquet. Il étendit progressivement son
travail à l'ensemble des sons glanés au musée au
cours de l'été 2002. Le pas pressé du conservateur
qui se rend d'une salle à l'autre, le grincement de la porte de
service, la surprenante acoustique et le craquement du parquet de la rotonde,
les applaudissements, les voix des visiteurs, le son du clavecin de Benoist
Stehlin (1750) et des extraits de l'audioguide furent captés puis
traités sur ordinateur. Cinq ambiances sonores sont ainsi nées,
plongeant l'auditeur dans des univers à la fois oniriques et fantastiques.
Le dispositif d'écoute de l'installation détourne également
l'un des équipements du musée: l'audioguide, cet appareil
portatif permettant d'écouter le commentaire pré-enregistré
de certaines oeuvres prestigieuses. Pour accéder à une plage
sonore, le visiteur doit composer sur l'appareil qui lui a été
spécialement remis dans le cadre de l'exposition, le numéro
apposé sur le lieu d'enregistrement des sons. La visite traditionnelle
du musée s'accompagne donc d'une quête des cinq ambiances
sonores, chacune correspondant à un espace différent.

(vidéo)
(vidéos)
par Hervé Cabezas
Conservateur du Musée Antoine lécuyer
![]()